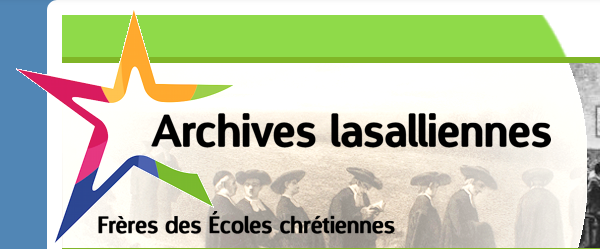https://www.archives-lasalliennes.org/docsm/2025/2505_ecoles-gratuites.php
Au risque de la gratuité
L’exigence lasallienne d’offrir une éducation économiquement accessible aux enfants des milieux populaires implique le souci constant de s’associer à des réseaux partageant la même volonté en vue d’assurer le financement des écoles. Ces préoccupations remplissent nos archives. Elles racontent les coopérations des Frères avec les autorités religieuses, politiques et économiques, en vue de tenir des écoles qui seront tantôt libres ou publiques… selon l’air du temps.
Une question de gratuité
L’engagement des Frères à tenir ensemble et par association les écoles gratuites (1694, 1718), puis à enseigner gratuitement (les pauvres) (1725, avec des variantes) a été une base de leur règle de vie dans sa formulation jusqu’en 1966. Un vœu de religion en cohérence avec celui de pauvreté. Cette insistance lasallienne sur la gratuité s’enracine dans l’appel paulinien à évangéliser (objet de l’école chrétienne), et à le faire gratuitement en réponse à un Salut toujours offert gracieusement. Cette annonce s’adresse de manière privilégiée aux « pauvres ».
Cet engagement des origines appelle les Frères à enseigner aux enfants pauvres, sans recevoir aucune rétribution directe des parents des écoliers, en mettant les écoles en étroite dépendance avec des fondations à même de les financer.
Tenir ensemble et par association les écoles gratuites est un projet éducatif qui va devoir s’affiner et s’adapter à des réalités économiques et sociales évolutives.
- La sélection des élèves selon leur niveau social soumet la charité et s’avère irréaliste : les Frères accueilleront tous les élèves… et devront alors se dresser contre les bailleurs de fonds qui voudraient opérer un tri social en amont.

- Le refus de toute rétribution scolaire – alors que les dynamiques économiques et politiques se font de moins en moins favorables – sera source de conflits et de procédures de plus en plus nombreuses avec les municipalités où les menaces de ruptures se croisent.
- Au souci du bon fonctionnement économique des écoles se rajoute celui des noviciats et scolasticats qui forment les jeunes religieux enseignants : il ne bénéficient d’aucun financement sauf à exiger une participation incluse dans les contrats avec les communes (précisée dans les prospectus édités depuis les années 1780).
- Les cas où la mise en œuvre d’une rétribution devient inévitable se multiplient – en France – mais également dans les pays où les Frères s’implantent au courant du XIXe siècle. Ces cas nécessitent des rescrits de la part de Rome, sorte de dispenses du vœu de gratuité ou d’interprétations assouplies et temporaires (1825, 1861, 1879, 1901) conduisant par exemple à percevoir des frais de scolarité proportionnés sur des périodes renouvelables jusqu’à équilibre financier.




Jusqu’à la Révolution, quelques sources de financement proviendront plus directement des pensionnats « libres » générant des frais de pension, et des pensions de Force financées par les autorités locales (ou les familles des internés) et que les Frères acceptent d’encadrer malgré la pesanteur et les risques de cette forme très particulière d’accompagnement. Dès l’origine, par ailleurs, les Frères ont investi dans le foncier et l’immobilier dans la perspective de revenus d’appoint.
Générosité chrétienne et reconnaissance publique

De l’Ancien Régime à la Grande Guerre, les mécanismes de financement privés reposent sur les legs (capital placé en rentes sur l’État, foncier, bâti) et les souscriptions (collectes de don).
Ainsi, un capital est confié par un fondateur de son vivant ou après son décès, à une commune, un comité de gestion (paroisse, bureau de charité, hospice), ou plus directement à l’Institut. Ces collectivités délèguent la gestion du fonds à un chargé d’affaire (banquier, notaire, magistrat – à qui il arrive de faire faillite).
Les rentes produites (perpétuelles ou limitées dans la durée) financeront tout ou partie d’une œuvre (on « fonde » ainsi une école, une classe, les pensions pour trois Frères, la scolarité de 50 enfants indigents, etc.) sous condition du respect des volontés du donateur – non contestée par les familles – et après validation du legs par les autorités civiles ou religieuses et les bénéficiaires. Le plus souvent ces volontés précisent que le don est effectué au bénéfice exclusif d’une « école primaire de garçons tenue par les Frères des Écoles chrétiennes », et sinon aux héritiers en cas de retrait des Frères. Les Frères s’engagent alors par contrat à attribuer le personnel nécessaire au fonctionnement de l’établissement au statut libre ou communal.


Le financement public à partir de 1808 (intégration du primaire lasallien à l’université impériale) est assuré par les communes tenues, par des lois et décrets toujours plus exigeants (1816, 1833, 1850…), de scolariser leur population. Elles font appel ou non à une rétribution scolaire pour les familles aisées en complément des subventions communales abondées par des taxes (octroi) ou les legs mentionnés précédemment.
Jusqu’aux laïcisations des années 1880, les écoles primaires communales (au statut publique ou libre selon les parts de financement) sont gérées conjointement par les autorités politiques, économiques et ecclésiastiques locales au gré de majorités fluctuantes. Elles bénéficient de financements mixtes privé-publique renégociés épisodiquement au fil des déséquilibres budgétaires (érosion des pensions, des rentes, augmentation des effectifs, etc.). Les motifs de litiges sont innombrables.
Avec les lois Ferry de1881-1882, la gratuité devient institutionnelle… mais elle est anti-religieuse.

Les laïcisations vont remobiliser les financements privés pour maintenir des écoles catholiques désormais libres, jusqu’aux lois d’exclusion de 1904. Celles-ci vont conduire à l’élimination des écoles les plus fragiles économiquement sur la période 1904-1959, alors que s’accroit l’instabilité économique et que s’enchainent les crises financières. Les péréquations entre grands pensionnats où des services annexes peuvent être payants, collèges secondaires à section technique parfois subventionnés et écoles au bord de l’asphyxie ne peuvent plus fonctionner.
L’appel aux frais de scolarité devient la règle quand il faut répondre aux nouvelles demandes éducatives et que les campagnes de collectes deviennent marginales, dans une société devenue parallèlement toujours plus libérale.
L’enseignement catholique populaire – héritier de la générosité chrétienne et de la reconnaissance publique – doit enfin sa survie aux subventions d’État permises par un cortège de lois favorables initiées par la loi Debré de 1959.




L’engagement éducatif a changé en réponse à des attentes et à des besoins qui ont évolué. L’impératif de la gratuité a pris un autre sens.
Dans la version de leur règle de vie révisée en 1966 et validée en 1986, les Frères font vœu d’association pour le service éducatif des pauvres. Cette expression intègre la gratuité dans un engagement plus global à l’objectif social et pastoral débordant le strict cadre du monde scolaire.
« Si la gratuité absolue de l’éducation scolaire peut se justifier dans certaines situations précises, la problématique de ce thème a profondément changé et ne se comprend plus dans les formes qui prévalaient lors des premières fondations lasalliennes. Il s’agit moins de savoir si les parents paient ou non une partie des frais scolaires que d’adapter les institutions éducatives aux besoins des plus démunis, de préparer les jeunes à des emplois utiles, d’assurer l’accès de tous à la culture, d’éduquer riches et pauvres au sens de la justice. L’option préférentielle pour les pauvres incite aussi les Frères et ceux qui travaillent avec eux dans le même esprit à développer les dimensions spirituelles et communautaires de la gratuité afin d’être, avec l’aide de Dieu, les éducateurs dont les pauvres ont besoin. »
Bruno Mellet